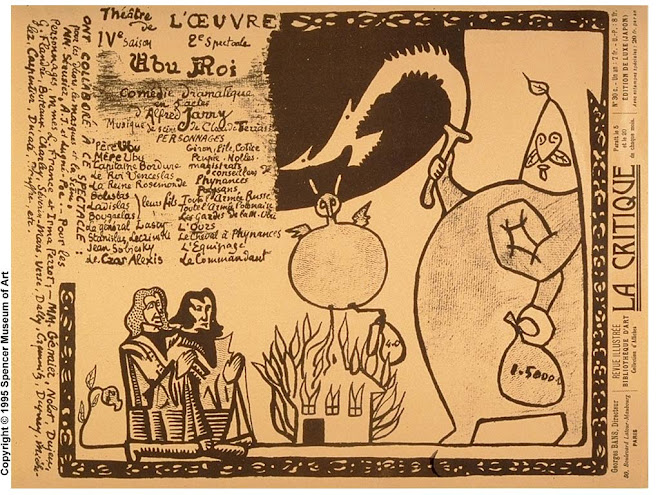Au-delà de la théâtralité, il n'y a rien d'intelligible, il n'y a que l'Impossible — qui relève de la métaphysique. On ne peut que revenir au fondement du « symbolique », le dégager de toute machinerie, si l'on veut, mais au-delà il n'y a rien, même pas la vie animale, la Nature. Le rien est la limite ultime à partir de laquelle toute Révolution est possible — c'est probablement ce qui fait la force, la beauté bouleversante et l'efficacité de La Commune de Peter Watkins : c'est précisément cette façon de mettre en scène la mise en scène, pour montrer la théâtralité du politique (cf. Godard, La Chinoise), en rapport avec ce qui demeure désormais le modèle encore inégalé, iconique, d'une authentique révolution populaire. Ainsi, l'architecture pense le temps.
Godard a bien compris ce qui relie la question des images et de l'Image, de la vérité et de la réalité avec la théâtralité au cinéma. Cela doit être mis en rapport avec la théorie de la mise en scène chez Eisenstein. Il y a d'ailleurs une certaine mauvaise foi sur ce plan chez Godard, semble-t-il, car il met toujours Vertov en avant, et à juste titre sur un certain nombre de points (en particulier pour une réflexion sur les relations entre cinéma et « actualités », cinéma et histoire récente, dont la télévision s'est arrogé le monopole). Mais pour ce qui est de la relation entre ces problèmes et la nécessaire théâtralité de la réalité, la dette revient incontestablement à Eisenstein : là est le vrai fond de sa polémique avec Vertov (voir notamment La Chinoise de Godard, ou Tout va bien). Godard renvoie à Brecht, comme presque tout le monde à l'époque : Brecht a le mérite de n'avoir pas été trop « compromis », semble-t-il, avec « le parti », on peut ne retenir chez lui que l'intégrité de sa lutte contre le capitalisme et le fascisme, sans être importuné par des fantômes embarrassants... reste que même les fondements de la théorie de la distanciation appartiennent à l'avant-garde russe, et surtout à Eisenstein qui en a donné la théorie la plus élaborée (le montage des attractions en particulier). Brecht était bien informé par ses collègues, et en particulier par Asja Lacis, qui s'occupait aussi de la promotion du cinéma soviétique.
Processus de « spatialisation » et d'« objectivation » de la subjectivité par le cinéma : à l'éclatement de l'espace autobiographique au cinéma (comme expérience) correspond l'éclatement de l'expérience à travers l'espace urbain, où le sujet subit des chocs ne se constituant en série que par lui, dans son appareil psychique. Le travail du montage est la constitution et l'extériorisation du plan de « consistance » de l'expérience-pensée de la dissolution de l'expérience vécue ou immédiate.
Au-delà de l'urgence politique, mais c'est aussi ce qui justifie cette urgence « métaphysiquement », l'impératif de transformation du monde par l'art renvoie à ses puissances propres pour la modernité (Benjamin/Brecht). Le régime représentatif, en effet assigne à l'art une fonction de continuité de l'Être et du pouvoir, exemplaire dans le cas du portrait du roi et dans la tradition juridique romaine de l'imago et du jus imaginum. En revanche, le droit minimal de chacun à donner et, doit-on ajouter, diffuser une, ou des images de lui-même, entraîne nécessairement une remise en cause permanente de l'ordre établi, en raison de l'hétérogénéité des singularités. La prolifération des images n'est que l'envers de cette possibilité. Il y a donc un lien entre la transformation de la perception du monde, le projet de transformation du monde (comme possibilité de l'impossible : utopie), les luttes sociales et culturelles (« sociétales », dit-on aujourd'hui), la question de la sphère publique et de la communauté et une philosophie de l'inconditionné (Kant), dont celles-là sont la manifestation.
Walter Benjamin ("L'auteur comme producteur") a attaqué la conception romantique de la littérature, rendue impossible dans les conditions nouvelles de production culturelle. La solitude de l'écrivain, entouré d'un petit groupe privilégié d'amis communiant dans une même sensibilité à l'Idéal, est devenu un mythe réactionnaire. L'écriture est désormais liée à un système de production, l'édition, la presse, tout aussi technique et collectif que le reste : l'écrivain ne doit pas ignorer les nouvelles conditions techniques et sociales de son art sous le prétexte que l'organisation libérale capitaliste de l'économie donne à ces conditions un aspect repoussant. Le développement technique et scientifique industriel et le degré d'intégration sociale de l'activité qu'il requiert est, dans son principe, transcendant à l'économie capitaliste, celle-ci n'en constituant qu'une étape historique ; son mouvement est même transcendant au concept d'histoire.
Un écrivain tel que James Joyce a déjà pleinement pris la mesure de ce problème : au lieu d'exprimer la lutte d'un sujet contre l'extériorité aliénante, l'écriture devient une production du collectif au travers de la constitution d'une âme, habitée par des voix et des perceptions multiples (l'âme, comme Pénélope, tissant, défaisant et tissant de nouveau le tissu du temps, métempsychose), de son émergence au cœur du cosmos de signes de la métropole. Joyce s'est explicitement opposé au romantisme : d'une part, en refusant de s'engager dans le mouvement nationaliste irlandais et dans son projet de forger une culture irlandaise de revival gaélique et, d'autre part, en s'affirmant classique.
La formulation de Valéry (Introduction à la méthode de Léonard de Vinci) peut paraître datée, voire désuète, par rapport aux enjeux de l'Art contemporain et de la nouvelle technologie numérique, mais, pourtant il y a des points communs dans les rapports entre forme, forme concrète et idée. Pour Valéry, la philosophie n'a aucune supériorité sur les arts, bien au contraire ; l'intelligible pur n'a aucune réalité et n'existe qu'en tant que principe interne à l'agencement de formes concrètes, capables d'émouvoir et de durer dans le monde, et de faire monde. De même une pensée purement rationnelle est impuissante si elle n'est pas en même temps poétique, c'est-à-dire créatrice, poïétique ; si elle n'agit pas d'une façon ou d'une autre. Enfin, le nominalisme est nié, dans la mesure même où le critère de vérité est l'émotion, liée à l'inspiration.
Cette problématique peut être transposée dans la réflexion sur la nouvelle technologie comme nouvelle condition de possibilité de l'Art contemporain et des arts en général, notamment sur les rapports entre programmes, images et effectivité. Hakim Bey (TAZ) a bien dénoncé les dérives d'une "cyber-gnose" se greffant sur des spéculations autour des notions de "virtuel" et d'"immatériel", de même que l'on prétend parfois réduire toute démarche réflexive sur les médias numériques à la question de la programmation, toute visualisation étant dès lors considérée comme inessentielle, de l'ordre de l'apparence ou de la forme ne donnant aucune prise pertinente sur les forces réelles qui se cacheraient derrière. Cela revient à réserver la philosophie de l'art ou l'esthétique et la création artistique à un très petit nombre d'experts, nouveaux Léonards. Mais ce "cyber-élitisme" est intenable philosophiquement, artistiquement, politiquement. Tout indique au contraire que la programmation est une voie de réflexion parmis d'autres, dans un monde irréductiblement pluraliste et à l'heure où émerge une nouvelle sphère publique qui n'entend pas se laisser mener par de nouveaux experts (voir "E-toy contre e-toys", in Connexions, art, réseaux, media, mais aussi le concept de zone d'autonomie temporaire selon Hakim Bey, Vilèm Flusser et toutes les réflexions sur le corps, indissociables de toute théorie cyber).
Dans tous les cas, il s'agit encore de lutter contre le nihilisme.
Dans L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, abondamment commenté, Walter Benjamin s'appuie, au cœur de sa démonstration, portant sur la transformation radicale des conditions de perception et de pensée à l'ère industrielle, sur une analogie entre cinéma et architecture, qui s'articule autour du concept de distraction.
Cette analogie n'est pas nouvelle : on la trouve déjà chez Elie Faure, par exemple, avec une même insistance sur le caractère collectif et civilisationnel de ces deux « arts » — mais aussi avec cette tension intéressante entre le fait qu'il s'agit, d'un côté, de l'« art » le plus ancien, en quelque sorte, et, de l'autre côté, de l'« art » le plus moderne.
Quel sera l'apport de Benjamin ? C'est évidemment le concept de reproductibilité, mais là encore mis en tension dialectique avec l'idée de transformation discontinue — que la radicalité d'une technique industrielle accomplie d'inscription et de répétition constitue une rupture anthropologique, mais soit en même temps le moyen technique de penser toute rupture et de faire de la rupture une véritable pratique destinée à surmonter le fatum, à entrer dans une temporalité du jeu non agonistique, une culture de la réciprocité et de la réversibilité, fondée sur une relation dialectique à la mort et aux morts, à la mémoire et à l'identité.
Le jeu, bien entendu, n'a rien à voir avec le « ludique », insulte courante dans le langage journalistique, mais avec une pensée de l'autonomie, qui convoque le rôle constitutif du jeu dans la genèse même de la singularité biologique et historique porteuse d'un nom, ou portée par un nom, la présence de l'aléatoire dans la constitution même de l'univers tel que la physique des particules permet de le penser et, de même, dans l'évolution des espèces et de leur diversité et, même, le rôle crucial de la catégorie du hasarddans l'art moderne, notamment chez Dada, mais aussi dans la connaissance (essais et erreurs, découverte, invention). C'est donc la dimension temporelle irréductible de l'imprévisibilité.
C'est aussi la question de l'écart (et de la limite) : comme lorsqu'il vaut mieux laisser du jeu dans un mécanisme pour qu'il fonctionne mieux et s'use moins vite, et jusqu'où, pour qu'il fonctionne tout simplement, qu'il y ait mouvement ; c'est aussi le « joint de dilatation » bien connu des architectes, qui prévient les désordres que peut causer au bâtiment le mouvement du sol (et dont le même principe se complique dans la construction antisismique, dont Franck Lloyd Wright fut un des pionniers). C'est le principe des variations parfois infinies à l'intérieur d'une règle en raison même de l'action des protagonistes. Mais aussi, dans la variation, le point de rupture d'une nouvelle série qui émerge et change toutes les conditions initiales. C'est pourquoi le terme de jeu permet de décrire avec efficacité l'ouvert, le rapport du possible et de l'impossible, au cœur de la vie sociale.
C'est donc précisément que le concept de jeu est fondamentalement lié à celui de transformation discontinue, en introduisant le « principe d'incertitude », et permet de repenser l'autonomie en faisant l'économie du concept téléologique, et théologico-politique, de progrès historique. Il s'agit donc de concevoir le concept indissociablement politique et culturel de Révolution, comme un besoin irréductible, lié à l'utopie, comme l'horizon toujours incontournable de la modernité, selon le principe de la transformation discontinue, opposée à la modification continue, liée à la prévisibilité et à l'éternel retour de la nouveauté.
Tel serait le fil conducteur, la ligne qui relie, par-delà leurs écarts et leurs tensions, les points de la constellation de L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique : le cinéma, la photographie, l'architecture, le théâtre, l'industrie, la ville, Dada, Chaplin, Mickey Mouse, Eisenstein, Vertov, Poudovkine, Brecht et la « politisation de l'art ». C'est aussi ce qui relie ce texte à des textes tout aussi cruciaux que : Paris, capitale du XIX ème siècle, Sens unique, les Essais sur Brecht, Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme ou « L'auteur comme producteur ».
Affect : rêve, geste, lapsus, comme séries signifiantes libidinales, irréductibles au logos. La stratégie du montage eisensteinien est celle d'une écriture désœuvrée, ou du désœuvrement, en quelque sorte, écriture a-logique, zaoum, comme pratique, dont les « œuvres » sont des restes, des archives, des suspens, de la dissociation, du dérèglement, du débitage. Une des formes de la violence, mais cela s'inscrit dans une économie darwinienne, adaptative, où c'est néanmoins la réflexion qui opère. Il y a une véritable exposition-distanciation de la violence, qui doit permettre de faire l'économie de la violence concrète. De même le recours délibéré à des modes d'enchaînement analogues à ceux de la psychose et du rêve, permettent d'en convertir le cours de l'inconscient collectif à l'agir collectif, à un mode supérieur de conscience collective, comme le pensent Benjamin et Krakauer, en accord avec Eisenstein, qui connaissait lui-même l'ambivalence des pouvoirs du cinéma.
Montage : rapport de parallélisme avec d'autres séries non discursives, hétérogènes, comme les associations d'idées, la remémoration ou mémoire involontaire, le rêve, la narration mythique, la psychose, la schizophrénie. Mais le montage cinématographique introduit ces séries archaïques dans une économie de la reproductibilité technique, les soumettant d'autant plus à la valeur d'exposition que le cinéaste en fera une méthode artistique, au sens d'une pratique réflexive.
Le rapport du cinéma au temps est actif et constructif, contrairement au théâtre, où il est passif, soumis à l'écoulement matériel de l'action. Le montage perceptible souligne ce rapport et il n'est donc pas fortuit de l'associer au nouveau paradigme artistique du constructivisme, paradigme d'une architecture industrielle baroque. C'est pourquoi il n'est pas étonnant non plus de rencontrer fréquemment la référence au cinéma soviétique dans les pratiques artistiques contemporaines de la performance (plus écrite et théatralisée que l'event et le happening, en principe) et de l'installation, dans la mesure notamment où ces pratiques sont généralement en interaction avec celles du cinéma expérimental, de la musique, de la vidéo et du numérique. Hétérogénéité et transformation les caractérisent par opposition à l'homogénéité et à la modification, discontinuité contre continuité, différence contre identité.
Dans les avant-gardes, le moment inaugural est Dada, dont l'originalité par rapport aux mouvements précédents (expressionisme, cubisme et futurisme italien, surtout) est précisément ce rôle central de l'hétérogénéité des moyens artistiques (en germe dans le collage cubiste, mais ni Picasso et ni, encore moins Braque, n'en tireront vraiment les conséquences, car si nous pouvons aujourd'hui y voir une entorse au principe d'unité du médium, l'intégrité plastique, le classicisme fondamental, de l'œuvre n'est pas réellement remise en cause) et donc l'abandon définitif de toute hiérarchie et de tout purisme, qui ouvrira vraiment la voie à l'Art contemporain dans ce qu'il a de plus fécond, en tant qu'attitude artistique (aussi la question ouverte par Dada est celle de l'autonomie de l'artiste, dans son acte, face aux pouvoirs et non celle de l'autonomie de l'art, ou de l'œuvre d'art). Il n'est donc pas fortuit que Benjamin voie en Dada la préfiguration de la transformation révolutionnaire de l'esthétique par le cinéma.
Le cinéma a donc bien plus affaire à l'espace qu'il n'y paraît, c'est un mode nouveau de relation du temps et de l'espace : le montage, opposé au défilement, à la représentation illusoire du temps comme coïncidence d'un flux et d'un enchaînement causal déterminé. L'image cinématique résulte du montage en tant qu'elle résiste au passage, à la disparition et, en même temps, en surmonte le pathos. Elle est sous-tendue par l'arrêt (d'où le rôle particulier qu'y joue la photographie, selon R. Bellour), elle est plus véritablement saccade et clignotement, ou scintillement, qu'écoulement (flickering, cf. P. Sharits), alternative que successive. Tout cela nous conduit donc près de la dialectique à l'arrêt chez Benjamin. L'arrêt transforme notre perception de la chose, de l'action, fait apparaître une série de gestes significatifs et donne à saisir et à penser l'événement. L'arrêt est solution de continuité, l'événement se définit à partir d'un seuil, d'un nouveau partage, provisoire mais irréversible, de l'intérieur et de l'extérieur, sur lequel il s'agira d'enchaîner.
« La transformation du lieu de l'action », c'est avant tout celle de l'écriture cinématique elle-même, son perfectionnement en vue de finalités politiques réfléchies, indissociable de l'écriture de l'événement à chaque moment. C'est précisément l'apport du cinéma soviétique et son prolongement dans le cinéma d'avant-garde et un certain cinéma documentaire (affranchi de la naïveté réaliste).
L'affect n'est pas dans ce qui serait alors son signe, il a à retrouver, à éprouver d'après une certaine « configuration », ce qui requiert une certaine forme d'attention, à travers la distraction, une vigilance paradoxale proprice à tromper le « surmoi ». Hasard dadaïste, reformulé par Breton en « hasard objectif » dans L'amour fou. Cf. Benjamin, Essais sur Brecht.
Architecture : allégorie de l'art de bâtir, selon Schelling ; cela veut dire que l'architecture se rapporte à une pratique sociale, politique, essentielle. Chez les Romains, en effet, bâtir était une activité noble en ce qu'elle bénéficiait toujours à la collectivité : voir par exemple la tradition des portiques et des arcs de triomphe et, bien sûr, l'importance des théâtres, du forum, de la basilique, des termes, etc. L'architecture a toujours été un art collectif, dès la préhistoire, où elle apparaît comme l'attestation d'une organisation très développée et complexe de la communauté (mégalithes).
C'est à partir de cela qu'il faut penser la présence et le rôle de l'architeture dans les arts plastiques et le cinéma.
« De la même manière que l'art est intégré dans la société, l'architecture des lieux consacrés à sa diffusion, est déterminée par les besoins d'ensemble de cette société et par l'art en tant que nécessité institutionnelle interne. L'art, en tant qu'institution, produit des significations et des positions idéologiques qui régulent et contiennent les expériences subjectives de ceux qui se trouvent placés à l'intérieur de ses frontières. Les œuvres et les écrits de Daniel Buren se concentrent sur la fonction particulière de la galerie en tant que lieu architectural et culturel dans la production du sens institutionnel de l'art. En général, tout espace institutionnel dispose d'une toile de fond, dont le rôle est de définir a contrario ce qui est mis au premier plan. Depuis les Lumières, les intérieurs publics sont, dans une large mesure, dépourvus d'ornements, géométriques, utilitaires et idéalisés. Ils offrent ainsi un fond blanc, clinique, uniforme, qui s'efface pour mettre en relief l'étendue des activités de l'homme. La galerie d'art est une application élégante de ce cube blanc traditionnel. Son rôle essentiel est de situer l'œuvre d'art, et la perception qu'en a le visiteur, au premier plan et, ce faisant, d'annihiler chez le visiteur toute conscience de sa propre réalité et de sa fonction. »
Dan Graham, « La relation art/architecture », Rock My Religion, Le nouveau Musée/Institut, Presses du Réel, 1993, p.32-33.
Comme le souligne Benjamin pour le concept de reproductibilité, le cinéma fait de la diffusion un problème esthétique en ce qu'elle a nécessairement une influence sur la conception du film, à travers ses conditions de production. En même temps, il n'y a pas de rapport univoque, puisqu'un film de budget très modeste peut connaître une grande diffusion. Cela est encore plus complexe avec l'apparition des supports vidéo et numérique, qui transgressent de plus en plus le contrôle de la diffusion par les salles de projection. C'est donc un problème indissociablement, inextricablement, esthétique, économique et politique.
La critique qui est à faire des différentes approches des relations entre art et cinéma est que, toutes, elles traitent l'architecture comme un contenant neutre, ou comme un champ indifférencié dans lequel se joue l'essentiel mais sans son apport. Il n'y a guère que dans le cas des salles de cinéma et, dans une moindre mesure, des décors, que le rôle de l'architecture est alors évoqué.
Nous nous proposons de nous attaquer à cette évidence. Ce « toujours déjà-là » du cadre architectural, qui est encore traité comme une matière en attente de sa forme politique, sociale, culturelle est au contraire la condition première de toute fixation, de tout enchaînement, des séquences techniques et culturelles, linguistiques qui engagent le processus d'hominisation. C'est ce que Leroi-Gourhan appelle l'esthétique fonctionnelle. Nous voyons donc que le lien intime, déterminant, d'autant plus qu'il demeure impensé, du cinéma à l'architecture, là même où apparaît une mutation technique autant que civilisationnelle historique, est très significatif.
Si l'homme habite en poète (Heidegger) c'est d'abord en tant qu'il fabrique et pense son environnement comme un artefact lié à des images spatiales de structures et de parcours, des séquences liées à l'inscription du corps (Cassirer), un corps armé, équipé, outillé, appareillé en modèle cosmique (cartographique) et premier support de la loi.
Infrastructure/superstructure : on pourrait se demander si l'architecture urbaine moderne n'est pas tout simplement une synthèse de ces deux pôles de l'activité humaine et, donc, de ce fait le « miroir » de leurs rapports, le plan sur lequel s'opère constamment leur rencontre et leurs interactions. D'où, là encore, l'importance des passages, des panoramas, etc. : ils seraient comme les images dialectiques de ces rapports ; la dialectique à l'arrêt étant l'interruption du mouvement dialectique incessant de l'histoire, se donnant à voir et à penser eidétiquement dans certaines architectures caractéristiques du temps, en lesquelles se dévoile à la fois la véritable physionomie du présent et ce qui permet de l'identifier, c'est-à-dire l'arkhê. Le paradoxe étant que cette image, présente dans l'architecture, n'est vraiment perceptible et ne se dévoile vraiment pour ce qu'elle est que dans des instants d'illumination (profane), le « maintenant de la connaissabilité », en dehors duquel il n'y a que le voile de la fantasmagorie, ne serait-ce que parce que l'architecture ne se perçoit réellement pour ce qu'elle est que « tactilement », distraitement, par une sorte d'attention flottante, oblique, non focalisée (non visuelle et non contemplative : en effet, même un monument dans lequel s'affirme un véritable travail de la forme doit être perçu en son site et avec son volume et son poids concrets qui ne sont donnés qu'à une mémoire corporelle tactile — quoi que l'on pense des postulats qui fondent sa pensée, nous devons à Piaget une observation précieuse sur l'importance fondamentale dans le développement de l'enfant de l'exploration tactile de son environnement. Voir aussi, peut-être chez Henri Vallon).
La question du cinéma serait alors de savoir s'il ne s'agit pas pour Benjamin d'un moyen technique de provoquer artificiellement l'expérience (Erfahrung) du maintenant de la connaissabilité, pour les masses, et de la fixer, c'est-à-dire d'en surmonter le caractère extrêment fugitif, intuitif, pour le singulier ; pour le dire autrement, il s'agirait bien, par le seul moyen du cinéma (seul média disponible à l'époque de Benjamin), de convertir le potentiel révolutionnaire de l'expérience poétique-artistique, enfermée dans les limites de la sensibilité singulière du poète ou de l'artiste (ce qui en fait une sorte de divination, comme en témoignent les dérives occultistes du surréalisme), en expérience collective. Serait-ce seulement une reprise du projet de Schiller ou cela va-t-il plus loin (la limite, pour nous, du projet de Schiller, c'est la notion d'éducation) ? Mais il semble que, pour Benjamin, il ne s'agisse pas d'éducation (ce qui supposerait un paradigme déjà établi), mais au contraire des conditions de la constitution collective d'une conscience commune de la multiplicité capable de transformation. Quel rôle joue la violence, par exemple ? Il semble en effet que, pour Benjamin, contrairement aux romantiques allemands, la violence révolutionnaire participe pleinement de cette expérience authentique : c'est la figure de Blanqui. On serait dans une pensée utopique au-delà du « projet de paix perpétuelle » kantien, trop marqué par le mouvement de la philosophie politique issu du traumatisme européen des guerres civiles du XVIe siècle (Hobbes en particulier) et dont la seule application ne peut être que le libéralisme.
Ainsi, l'interaction constante du cinéma et de l'architecture, en raison de leur mode commun de perceptibilité (tactile, distrait : ce qui, pour le cinéma n'est pas toujours évident, puisque une manipulation habile des mouvements de caméra et du découpage, effaçant les solutions de continuité et interdisant toute distanciation, simulant « l'expérience vécue » (Erlebnis) est également possible, recréant des effets hypnotiques, hallucinatoires) serait le moyen de susciter un mode d'expérience révolutionnaire contre l'idéologie du progrès.
Ce problème est toujours à l'ordre du jour, puisque l'organisation des médias en réseaux favorisant des modes de relation sociales dialogiques et non hiérarchiques (Flusser), doit pouvoir s'appuyer sur un travail critique rigoureux de la forme (Watkins) tant il est aujourd'hui patent que la seule possibilité de ces relations ne suffit pas à engendrer une véritable culture. Faute de quoi, les « élitistes », les partisans d'une organisation hiérarchique (en faisceaux, dit Flusser), bien que pleinement technique, de la production culturelle auront toujours raison in fine.